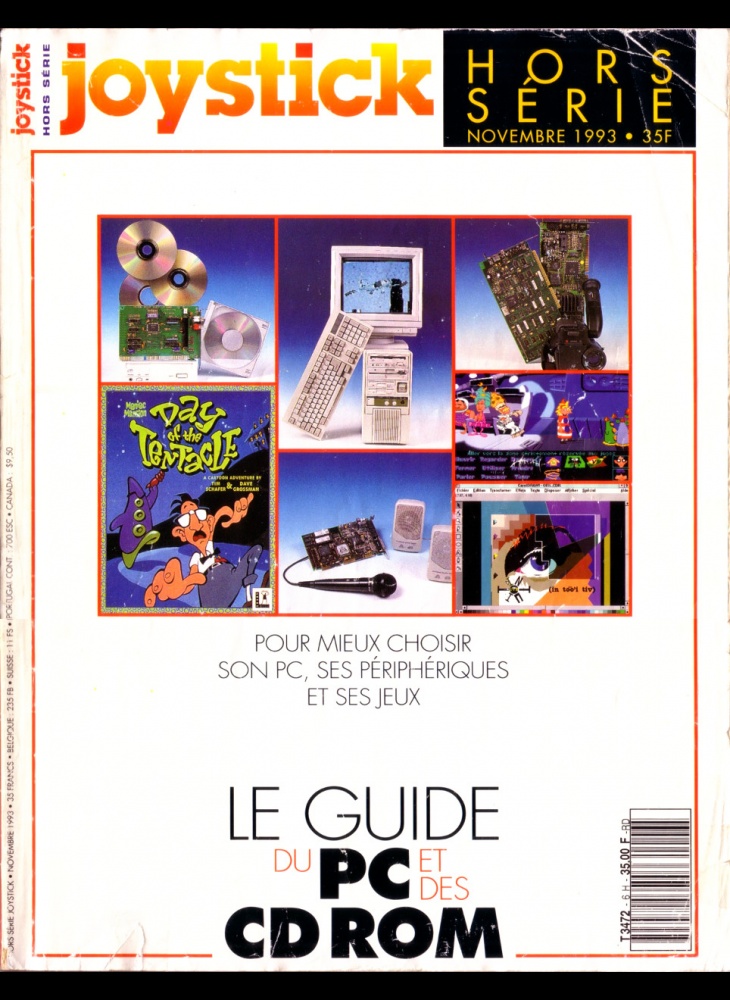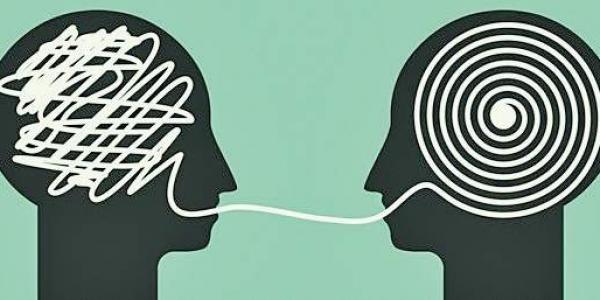Le grand malentendu
Par Shane Fenton • le 31/5/2019 • Entre nous •Quand on parle du jeu vidéo sur la place publique, quand le jeu vidéo fait l’objet d’un article de journal ou de site généraliste, d’un reportage télévisé, d’une émission de radio… force est de constater que les réactions peuvent être polarisées, encore aujourd’hui. Et on en revient souvent, même si ce n’était pas le sujet initial, même si on ne voulait traiter que d’une partie d’entre eux, à une opposition binaire, totale et sans nuance : pour ou contre les jeux vidéo dans leur ensemble.
Quand on y réfléchit, un amateur de jeux vidéo (au sens premier du terme, « qui aime sa pratique », à l’image d’un cinéphile) ne devrait pas se sentir visé par une attaque contre la seule violence vidéoludique. Ou contre « l’industrie », dont on n’est pas a priori membre. Ou contre le caractère « addictif » de certains jeux. Ou contre un titre en particulier, que ce soit Grand Theft Auto ou Fortnite (surtout si on n’y joue pas soi-même). Ou contre les effets « des écrans » en général sur les enfants, plus particulièrement les tout-petits (0 à 2 ans) qui ne sont pas a priori concernés par le jeu vidéo. Et pourtant, le malentendu est total.
Petits tracas sémantiques
Une anecdote relativement récente (c’est-à-dire, « vieille » de moins de 10 ans) permet de l’illustrer. En 2011, à la suite d’une agression mortelle à la sortie d’un collège, une Ministre a voulu y voir un lien entre « une augmentation de l’ultra-violence » et « le développement de certains films très violents ou de certains jeux vidéo ». Un journaliste a cru malin d’en déduire que la question se posait de savoir si « les jeux vidéo rendent violent ». Quand un psychologue interrogé sur la question a répondu par la négative, un chercheur et un pédopsychiatre l’ont perçu comme une attaque contre la recherche sur les effets des jeux « violents » (ainsi que contre leurs propres observations sur le terrain), et ont volé au secours de cette dernière. En retour, ils se sont pris une volée de bois vert de la part de joueurs qui l’ont pris comme une attaque contre leur loisir. Ils n’ont pas compris, ni l’ampleur des réactions, ni leur virulence. Ils n’ont pas davantage compris que leurs contradicteurs se sentent visés quand ils parlaient « des jeux vidéo » alors qu’ils ne voulaient parler que de la portion « violente » d’entre eux (« Vous avez l’air de penser que nous aurions dû préciser « violents » après chaque occurence de « jeux vidéo »! Ca me semblait aller de soi, que nous parlions de ceux-là, dans le contexte et pas d’Adibou aux pays des Bisounours… »). Et ils n’ont pas non plus compris l’identification des joueurs à leur pratique, ou au médium dans son ensemble : « il me semble, par comparaison, [que] je peux dire que Maître Gims c’est de la musique de merde, ça ne va pas énerver un amoureux de Jean-Sébastion Bach! ».
Il y aurait beaucoup à dire sur les facteurs à l’origine de ce malentendu et de cette polarisation extrême. L’un d’entre eux, à mon sens, est la couverture médiatique sur le jeu vidéo, initialement hostile et méprisante. En témoignent des articles aux titres aussi explicites que « La drogue des jeux vidéo » (Le Monde Diplomatique, novembre 1993) ou « Il faut détester les jeux vidéo » (Marianne, 28 décembre 1998). Hostilité qui se traduit aussi dans la manière de présenter au public les études sur les effets de la violence vidéoludique, brandies comme la preuve scientifique indiscutable que les jeux vidéo dans leur ensemble étaient mauvais et dangereux. Là encore, un seul exemple, relativement récent, suffit à illustrer ce biais : en 2012, lors de la parution d’une étude expérimentale sur les effets à long terme des jeux « violents », l’un de ses auteurs a pris soin de rappeler qu’il ne s’en prenait qu’au contenu « violent » de certains jeux, pas au médium en tant que tel. Cette précision a été complètement ignorée par la majorité des commentateurs, que ce soit d’un côté (un article de Marianne du 20 octobre 2012, subtilement intitulé « Pourquoi les jeux vidéo rendent parano », commençait par cette interrogation, « Gangsters, les gamers ? », avant de nous expliquer ensuite que cette étude donne raison aux « contempteurs de World of Warcraft« ) ou de l’autre (voir cette réplique dont le titre annonce la couleur : « Le jeu vidéo responsable de tous les maux ou victime des mots ? »).
Lune de fiel
De nos jours, la presse généraliste est, dans son ensemble, nettement plus favorable aux jeux vidéo. Cela s’explique en partie par la présence, dans la plupart des organes de presse, de rubriques et de journalistes spécialisés (issus pour certains de la prese vidéoludique). Ce qui provoque régulièrement la colère d’une poignée de lecteurs, qui ne comprennent pas qu’on parle autant d’un tel sujet, avec autant de bienveillance. Appuyons-nous encore une fois sur des exemples récents.
En 2016, une étude commandée par le ministère de la culture établissait que seuls 7% des Français considéraient le jeu vidéo comme un objet culturel. Un article du Monde (journal qui dispose depuis 5 ans d’une rubrique, Pixels consacrée aux jeux vidéo et au numérique), se demandait pourquoi, en interrogeant différents acteurs du milieu. Un tweet d’une journaliste du Figaro qui a elle aussi couvert le jeu vidéo en long et en large, a apporté sa propre réponse : « Tant que jeux vidéo rimera avec Call of et Fifa dans la tête des gens, ça ne risquera pas de changer. » Décalage illustré par deux commentaires particulièrement négatifs. Un qui déplorait un « article pathétique » et se réjoussait que « les français résistent à ce que l’industrie cherche à nous faire gober avec la complicité du Monde ». Et un autre, encore plus explicite dans son rejet, à la fois de l’article et du médium :
« Le jeu vidéo n’a pas la valeur intellectuelle d’un livre parce qu’il n’invite l’esprit ni au mouvement, ni au questionnement, ni à la création. […] Il exalte souvent la violence, abolit la compassion, isole.[…] C’est un produit, façonné par la finance pour une certaine audience, une certaine couche démographique de la population. […] Il n’a de valeur artistique que celle que veulent bien lui donner les études de marché. Il est l’une des expressions les plus sournoises de notre société capitaliste. En attendant, chers consommateurs, il faut aller remplir les poches des patrons. Nous résistons encore à nous ouvrir au marché du jeu vidéo ? Qu’importe ! Qu’on nous convainque à coups d’articles propagandistes (ceux qui possèdent Le Monde y ont un intérêt évident). Le pognon n’aime pas attendre.
En réponse, Le Monde a publié un autre article, présentant dix jeux allant à rebours du cliché selon lequel le jeu vidéo est « une simple distraction, dépourvue de sens et se complaisant dans la violence », dix titres « qui montrent le jeu vidéo autrement ». Cet article a lui aussi été critiqué, mais pour sa vision prétendument élitiste et condescendante du médium. Au grand dam d’un des auteurs de l’article, qui constate « la difficulté, voire l’impossibilité de parler en même temps au très grand public, aux joueurs occasionnels, et aux connaisseurs », qu’il estime spécifique au jeu vidéo : « Je ne vois sincèrement pas d’autre média où la barrière à l’entrée, le clivage générationnel et l’ignorance imposée par la difficulté de pénétrer dans l’expérience sont aussi élevées et segmentants. »
Même quand le sujet de départ ne concerne qu’un aspect du jeu vidéo qui n’est pas susceptible de dériver vers une opposition « pour » ou « contre » le médium, par exemple les conditions de travail dans l’industrie, certains commentateurs ne peuvent pas s’en empêcher :
Les jeux vidéos [sic] rendent des générations amorphes et obèses, incapables de lire 20 pages d’un vrai livre. C’est une industrie socialement nuisible. Je n’ai aucune compassion pour les déboires des salariés, les développeurs sont courtisés dans tous les secteurs, qu’ils aillent faire autre chose au lieu en plus de peiner chez ces éditeurs. Et merci pour cet article qui montre qu’au moins les souffrances ne sont pas que du côté des mères d’ados rendus addicts à ces saletés.
Ce déversement de bile et de fiel n’a pas grand intérêt en soi. Il est d’ailleurs assez rare, épisodique, limité aux commentaires (alors qu’il y a encore quelques années, il était affiché sans complexe par certains éditorialistes, comme nous l’avons vu plus haut) et généralement, vite contredit par d’autres lecteurs. A l’opposé, les articles négatifs, ou simplement critiques, sur le jeu vidéo ou un de ses aspects, suscitent des réactions de défense du loisir qui peuvent être aussi bilieuses et fielleuses, mais qui sont surtout bien plus nombreuses (nous en avons suffisamment parlé pour avoir à y revenir).
Il serait intéressant, par contre, de se demander pourquoi le jeu vidéo suscite, encore aujourd’hui, autant de polarisation. Pourquoi tant de haine ? Qu’est-ce qui fait que tous ces gens se sentent personnellement agressés, les uns par une critique négative d’un jeu, d’un usage, d’un aspect qui ne les concerne pas forcément (il m’est arrivé, encore récemment, de prendre pour moi une attaque contre Fortnite alors qu’à l’heure où j’écris ces lignes, je n’y ai jamais joué), les autres par un éloge du médium ou d’un titre jugé méritant ? Au point que leur premier réflexe est de réagir avec une agressivité qu’ils estiment à la mesure de « l’attaque » qu’ils ont subie ? D’où provient ce malentendu ? Quelles en sont les raisons ?
Pratique directe (et indirecte)
Encore une fois, il faudrait une série d’articles pour toutes les identifier. Mais j’aimerais me pencher sur celle qui me paraît la plus importante et la plus profonde : si nous nous sentons obligés de nous positionner « pour » ou « contre » les jeux vidéo à chaque fois qu’on les mentionne, et si l’opposition entre les « pour » et les « contre » peut atteindre de tels sommets de violence et d’aigreur, c’est parce que nous ne sommes même pas d’accord sur le sens à donner à cette expression fondamentale, « les jeux vidéo ».
En reformulant le problème par une question : que veulent dire « les jeux vidéo » pour nous ? Que sont-ils pour nous ?
De mon point de vue, le sens que l’on donne à cette expression, « les jeux vidéo », provient de trois sources : ceux que l’on pratique soi-même, ceux que notre entourage pratique (qui quand on ne joue pas soi-même, deviennent en quelque sorte des « ambassadeurs » du médium), et ceux dont on entend parler par d’autres sources (presse spécialisée, journaux généralistes, radio, télévision…). Et pas forcément dans cet ordre d’importance.
En effet, dans mon cas, ma pratique personnelle initiale des jeux vidéo s’est limitée pendant des années à quelques parties dans les salles d’arcade, puis à une poignée de titres, sur MSX d’abord, puis sur les consoles Sega de l’époque (Master System et Megadrive). A elle seule, elle n’aurait certainement pas suffi à me rendre passionné. Pas plus que la pratique de « mon entourage », qui s’est limitée pendant quelques années à mon frère et aux enfants des voisins, avant de se réduire à rien du tout. Ce qui a réellement fait naître chez moi une passion durable pour ce médium, c’est avant tout la presse spécialisée de l’époque : Tilt, Micro News, Génération 4, Joystick… Cette presse qui m’a montré toute l’étendue du paysage vidéoludique, surtout sur micro-ordinateur. Cette même presse grâce à laquelle ma passion a demeuré, et s’est même accrue, alors que je n’ai plus joué à rien pendant deux ans (mon frère avait quitté la maison familiale, ce qui me laissait sans partenaire de jeu et m’avait fait perdre tout intérêt pour la Megadrive vieillissante, tandis que l’acquisition d’un PC était hors de ma portée de lycéen). Aujourd’hui encore, alors que ma ludothèque PC a atteint grâce à Steam et à GOG des proportions obscènes, c’est ma lecture de cette « presse spécialisée » (au sens large : sites, blogs, forums, twittos…), plus encore que le temps irrégulier que je peux consacrer à certains titres, qui alimente ma curiosité et mon intérêt pour le médium dans toute son étendue, et qui fait que je peux toujours me considérer comme un passionné de jeux vidéo.
C’est également la lecture de toute cette presse spécialisée qui fait que j’ai envie de rejeter violemment les attaques généralisantes contre le jeu vidéo. A titre d’exemple, il suffit que je prenne un magazine vidéoludique de 1993 (Joystick ou Génération 4) sur les meilleurs jeux PC, et que je compare son contenu avec les seuls aspects du jeu vidéo qui avaient retenu l’attention des médias généralistes la même année (à savoir : l’épilepsie, la violence, Super Mario responsable d’une prise d’otages, etc…), pour que la moutarde me monte au nez.
Mais justement, qu’en est-il à présent des personnes qui se livrent à ces « attaques généralisantes » ? Que représentent « les jeux vidéo » pour elles ?
Voilà donc le succès qu’aura votre ambassade
Reprenons le commentaire d’article que nous avons cité plus haut. Reprenons en particulier ce passage sur « les souffrances [qui sont] du côté des mères d’ados rendus addicts à ces saletés. » Ce passage veut tout dire. On peut, sans trop s’avancer, imaginer qu’on a affaire à une de ces mères de famille pour qui le jeu vidéo se réduit à la pratique de leurs enfants et à la souffrance générée par une mauvaise gestion de cette pratique. Partant de là, on peut en déduire que si cette mère de famille a devant les yeux un article traitant des « effets positifs » ou de la « valeur culturelle » du jeu vidéo, ou même d’un seul de ses titres, elle pourra le prendre comme une insulte à son intelligence, ou pire, comme une négation de sa souffrance. A elle aussi, la moutarde va monter au nez. Ce qui va se traduire le plus souvent par ce genre de commentaires, où toute la bile accumulée va pouvoir se déverser. Dans certains cas, ces parents dépassés vont trouver du soutien et du réconfort auprès d’associations créées par un de leurs semblables pour les aider, eux et les anciens accros aux jeux repentis, à surmonter leurs problèmes. Par exemple, Online Gamers Anonymous aux Etats-Unis, créé sur le modèle des Alcooliques Anonymes par Elizabeth Wooley, dont le fils Shawn s’était suicidé suite à une pratique compulsive d’Everquest (pour l’anecdote, elle avait attaqué en justice les distributeurs du jeu, et son avocat n’était autre que notre vieille connaissance Jack Thompson). Ou l’association allemande Aktiv Gegen Mediensucht (« actifs contre l’addiction aux médias »), créée par feu Christoph Hirte et sa femme Christine, dont le fils était accro à World of Warcraft.
Puisqu’on parle des anciens accros repentis, on se rend compte qu’une connaissance intime des jeux vidéo n’immunise pas contre les attaques généralisantes. Au contraire, car de son propre cas, on est souvent tenté de faire une généralité. Que ce soit Michael Wallies en Allemagne, Cam Adair au Canada, ou les nombreux « ex-addicts » américains dont l’expérience a fait l’objet d’un livre ou d’une association d’aide à leurs semblables (la littérature est assez abondante, mais on citera en particulier Andrew Doan, son livre Hooked on Games, et son association Real Battle Ministries), ces anciens joueurs compulsifs, voire pathologiques, ont souvent tendance à brûler ce qu’ils ont adoré avec la même absence de modération. Pour eux, « les jeux vidéo », ce sont avant tout ceux qu’ils ont pratiqué, de la manière dont ils l’ont pratiqué, souvent en accord avec la manière dont ils ont été conçus par les éditeurs de ces jeux (les théories sur le « behavioral game design » et le « persuasive design », largement répandues, ont fourni des caisses entières de munitions aux personnes qui militent pour la reconnaissance de « l’addiction » aux jeux et aux écrans en général). Partant de là, on peut comprendre leur rancune vis-à-vis des pratiques de ces éditeurs, qu’ils vont assimiler à l’industrie toute entière. Et on peut comprendre qu’ils soient hermétiques aux interrogations sur l’art et la culture, dont ils se contrefichaient à l’époque où ils jouaient (tout comme les éditeurs mentionnés, serait-on tenté de dire). Il est même probable qu’eux aussi considèrent ces interrogations, à la fois comme une insulte à leur intelligence et comme une négation de leur expérience et de leur souffrance. Sauf que cette fois, ce sentiment de foutage de gueule va s’appuyer sur leur pratique intime du médium. Ils vont se souvenir du contenu des jeux qu’ils ont pratiqué, parfois abrutissant, « bêtement » addictif parce que conçu comme tel. Ils vont lire et relire les théories sur lesquelles certains éditeurs et concepteurs se sont appuyés pour rendre leurs produits addictifs. Ils vont repenser à la manière dont ils pratiqué ces jeux, et aux conséquences de cette pratique sur eux comme sur leurs proches. Et ils vont comparer le tout avec les nombreux éloges des bienfaits du jeu vidéo sur la santé, la jeunesse, l’éducation, la société… Il est prévisible qu’à leur tour, la moutarde leur monte au nez.
Outre les anciens joueurs accros et leurs parents, on peut évoquer leurs conjoints, les veufs ou veuves de jeu (en VO : « game widow » ou « gamer widow »), qui subissent à leur manière les conséquences de cette pratique. Une amie à moi s’est un jour retrouvée dans ce cas : son copain s’est retrouvé tellement absorbé par ses jeux PC et ses parties avec ses copains qu’il finissait par la délaisser complètement, et qu’il ne la considérait plus que comme une pause entre deux parties. Pour cette raison, elle qui n’avait rien contre les jeux vidéo à la base, a fini par les rejeter en bloc : « là, récemment, on parlait jeux vidéo. Il m’a demandé pourquoi je ne jouais pas à ses jeux (LOL, Hearthstone…). Je lui ai dit que j’en étais à détester les jeux parce que je leur associais la distance entre [lui] et moi et qu’à choisir, je préférais haïr un jeu plutôt que mon copain. » Tout est dans cette dernière phrase. Quand la pratique du jeu vidéo devient compulsive, voire pathologique, tout le monde en souffre, et cette souffrance peut évoluer en colère. La question qui se pose alors est la suivante : contre qui, contre quoi, diriger cette colère ? Est-ce qu’on va se mettre à haïr la personne qu’on aimait autrefois, cette personne proche qu’on ne reconnaît plus ? Est-ce qu’on va se haïr soi-même pour n’avoir rien vu, pour n’avoir pas su empêcher ce changement, pour être devenue moins intéressante qu’un jeu ou une machine ? Ou est-ce qu’il n’est pas plus simple de projeter sa haine et sa rancune contre l’objet de ce changement, les jeux qui ont causé tant de souffrances au sein du foyer ? Quitte à viser également les créateurs, producteurs et promoteurs de ces jeux ?
Pour compléter le tableau, il reste le cas des professionnels de l’enfance, de la santé, de l’éducation… qui ont un contact plus distant, mais néanmoins régulier, avec ces « ambassadeurs malgré eux » du jeu vidéo. Le pédopsychiatre évoqué plus haut m’a confié que son intérêt pour ce loisir était « biaisé » pour deux raisons. La première vient justement des jeux qui l’intéressent, à savoir ceux auxquels s’adonnent ses patients. On devine aisément qu’il s’agit de titres « grossièrement inappropriés » pour leur jeune âge, que leur pratique n’est pas spécialement équilibrée, et qu’elle n’est pas sans conséquences sur leur bien-être ou sur leur scolarité. La deuxième raison vient de l’attitude de certains de ses collègues, qui d’un côté, vont soutenir mordicus que ces jeunes patients ne sont en rien affectés par leur consommation d’écrans, et de l’autre, vont les bourrer de médicaments pour soigner d’éventuels « troubles du comportement ». Pour lui, « les jeux vidéo », ce sont d’abord et avant tout ceux pratiqués par ses patients, de la manière dont ils sont pratiqués par ses patients. Et « la défense des jeux vidéo », c’est d’abord et avant tout celle qui est pratiquée par ses collègues qui vont recourir d’office à des traitements médicamenteux. Du coup, quand il s’exprime publiquement sur le sujet des jeux vidéo, il commence souvent par lire un extrait d’un article élogieux sur leurs nombreuses vertus, avant de balancer une vidéo d’extraits « trash » du dernier GTA en guise de démenti cinglant. On peut contester le procédé, mais il faut se rappeler qu’il ne fait que parler des jeux qui constituent le quotidien (et probablement l’unique quotidien) de la plupart de ses patients depuis plus de 10 ans. Il est facile de comprendre pourquoi, à lui comme à d’autres professionnels dans le même cas, la moutarde peut monter au nez : il suffit de repenser à cette expérience quotidienne, à ces patients qui semblent n’intéresser qu’eux, au déni de leurs collègues qui préfèrent recourir d’office aux médicaments, et aux discours élogieux sur les bienfaits du médium qui entrent en contradiction flagrante avec leur expérience.
Le beurre et l’argent du beurre
Cela dit, il serait erroné de croire que la source du malentendu provient juste d’une ignorance mutuelle des titres dont parle chaque « camp », et qu’il suffirait par conséquent de la combler par une présentation de quelques titres « qui montrent le jeu vidéo autrement » (dixit l’article du Monde cité plus haut). Les « défenseurs du jeu vidéo » connaissent forcément GTA et son contenu controversé. Les opposants à la violence vidéoludique et à la consommation excessive des écrans sont au moins prêts, la plupart du temps, à concéder que « tous les jeux vidéo ne sont pas mauvais », et avec un peu de chance, ils peuvent même donner des exemples de titres qu’ils trouvent « bien » (à savoir : les Civilization, les Sims, les serious games…). Le problème n’est pas qu’ils ignorent les « bons » jeux, mais plutôt qu’ils s’en contrefichent, puisque ces « bons » jeux n’ont aucune place dans le quotidien des joueurs de leur entourage immédiat (que ce soient des enfants, des proches ou des patients). Ils ne s’y intéresseront que quand ces joueurs, uniques ambassadeurs du médium auprès d’eux, s’y adonneront (dixit mon correspondant pédopsychiatre : « le jour ou j’entendrai un enfant que je rencontre jouer sur un simulateur de nuage blanc, je crois que je vais tomber de ma chaise »). A l’époque où Minecraft n’était pratiqué que par une petite poignée « d’élus » et qu’il était snobé par la presse vidéoludique elle-même, ils ne l’auraient pas remarqué non plus et n’auraient pas voulu en entendre parler. A présent que c’est devenu le phénomène mondial que l’on sait, ils sont forcés d’en tenir compte. Ou plutôt, soyons précis, ils tiennent compte de son succès phénoménal, de la manière dont il est pratiqué par leur entourage direct (surtout les enfants), des effets de cette pratique, et des articles à sensation consacrés à ces effets réels ou supposés. Le jeu lui-même et ses possibilités, ils s’en contrecarrent. Seul compte pour eux la manière dont il est (majoritairement) pratiqué, et ses conséquences.
Ce qui nous permet de découvrir une autre facette du grand malentendu : quand on parle des jeux vidéo, est-ce qu’on parle vraiment du jeu vidéo ? Cette distinction entre singulier et pluriel n’est pas qu’une coquetterie sémantique : elle cache un abîme d’incompréhension. A mon sens, parler du jeu vidéo, c’est parler du médium lui-même, donc de ce qu’il a de « meilleur ». Comme on fait la distinction entre les films et l’art qu’on appelle le cinéma, ou entre les livres et l’art qu’on appelle la littérature (on peut en dire autant de la bande dessinée). Partant de là, si on veut discuter de la valeur artistique et culturelle du jeu vidéo, il va de soi, à mes yeux, qu’il faut considérer d’abord et avant tout le « meilleur » de la production, indépendamment du succès commercial ou du nombre d’utilisateurs (même si l’un n’empêche pas l’autre). Pour reprendre l’exemple de Minecraft, s’il mérite de faire partie du « meilleur » de ce que le jeu vidéo a à offrir, ce n’est certainement pas parce qu’il a été vendu à plus de 150 millions d’exemplaires (il en serait resté à un demi-million qu’il aurait gardé la même valeur intrinsèque), mais grâce aux plus belles réalisations de ses utilisateurs.
A l’opposé, parler des jeux vidéo, c’est parler, non pas du médium lui-même, mais de la manière dont il est majoritairement pratiqué (les jeux les plus utilisés, les producteurs qui ont le plus de poids, les utilisateurs les plus assidûs), et des effets de cette pratique sur la société. Et on en revient aux personnes qui s’alarment de la surexposition aux écrans : les seuls jeux vidéo qui comptent, ce sont ceux auxquels s’adonnent leurs proches ou leurs patients en souffrance, alors que ces jeux sont « grossièrement inappropriés » pour eux. Les seuls créateurs de jeux qui comptent, ce sont les grosses entreprises multinationales qui éditent et produisent ces jeux-là. Les seules « pratiques » vidéoludiques qui comptent, ce sont celles de leurs proches ou de leurs patients, le plus souvent totalement déstructurées, désordonnées, déraisonnables, c’est-à-dire « grossièrement inappropriées », là encore. Partant de là, les seuls effets qui comptent, ce sont les effets de ces pratiques, appliquées à ces jeux sur ces proches ou ces patients. Il est, dès lors, inutile de leur demander de mieux se renseigner sur le « meilleur » du jeu vidéo, puisque dans le fond, le jeu vidéo ne les a jamais intéressés.
Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte
Voilà pour moi la raison pour laquelle, quand les deux « camps » se croisent, il en résulte le plus souvent un dialogue de sourds, voire une guerre de tranchées. Chacun des antagonistes va parler de « jeu(x) vidéo » en lui associant une réalité et une expérience qui contredit complètement celles de l’autre. Et chacun va s’arc-bouter sur sa propre définition, son propre sens, parce que c’est le seul auquel il est confronté. D’un côté, quand un « défenseur du jeu vidéo » va dire du bien de son loisir, un « adversaire de la violence vidéoludique » (ou plus largement de la « surconsommation d’écrans ») va en déduire qu’il cautionne les pratiques vidéoludiques « grossièrement inappropriées » dont il a été témoin, et que par extension, il est co-responsable, voire complice, de cette situation et de son aggravation. Il va considérer ce « défenseur » avec le même mépris et la même hostilité que les dealers et les racketteurs qui font la sortie des collèges. De l’autre, quand un « adversaire de la surconsommation d’écrans » va casser du sucre sur le dos des jeux vidéo dont il a été témoin des effets sur ses proches ou ses patients, le « défenseur du jeu vidéo » va s’imaginer qu’on attaque son loisir à lui, et ses propres pratiques à lui. Donc qu’on l’attaque personnellement, lui ou ses camarades. Il peut en résulter dans les les deux cas une réaction épidermique et agressive : puisque chacun d’entre eux va considérer qu’on l’agresse lui ou ses proches, il va répondre sur le même ton. Et l’autre, qui va se prendre toute cette agressivité en pleine figure, ne va pas comprendre. Le « défenseur du jeu vidéo » ne va pas comprendre pourquoi un loisir dont il a vu le meilleur va faire l’objet d’une telle haine, d’une telle volonté d’ignorer et de nier ce qu’il peut avoir de meilleur. Et « l’adversaire de la surconsommation d’écrans » ne va pas comprendre qu’on puisse défendre « des jeux vidéo », des industries multimilliardaires, et des pratiques dont il a vu le pire.
Que faut-il en conclure ? Que si chacun des deux camps mettait de l’eau dans son vin, un dialogue pourait s’instaurer ? Pas forcément.
Pour commencer, il faudrait se poser la question de savoir si un dialogue est souhaitable, ou même nécessaire. On pourrait penser après tout que « le jeu vidéo a gagné », et que ça ne sert à rien de se préoccuper des rares derniers ilôts de protestation qui se limitent à une poignée de commentaires aigris et d’éditos à côté de la plaque, qui vont au mieux générer une semaine d’effervescence, avant de retomber aussi vite dans l’oubli. Je fais plus ou moins partie du club, même s’il m’arrive de déceler, dans cet empressement à ignorer ces provocations qui ne méritent pas notre attention, une crainte de réveiller les vieux démons du passé, quand il suffisait d’une seule association familiale pour déclencher une tempête médiatique et juridique sans pareil (chaînes de magasins attaquées en justice, jeux retirés purement et simplement des rayons, magazine vidéoludique condamné pour diffamation, formation d’une commission chargée de contrôler le contenu des titres avant leur distribution, etc…). Vingt ans après « l’affaire Familles de France », la violence médiatique et vidéoludique n’est pas un sujet susceptible de mobiliser les foules, ou de passionner grand-monde.
Cela dit, s’il n’y a plus grand-monde pour s’offusquer du dernier Mortal Kombat, en revanche le nombre de parents inquiets par la multiplication et l’omniprésence des écrans (dont la question de « l’addiction » aux jeux vidéo n’est qu’une facette) ne risque pas de diminuer. Il y aura toujours des parents inquiets (pléonasme ?), peu importe leur rapport au jeu. Il y aura toujours des « non-joueurs », c’est-à-dire des gens qui auront peut-être eu une expérience du jeu vidéo par le passé, mais qui n’auront pas le temps ni l’envie de s’y investir plus avant, et qui l’aborderont « de l’extérieur », à partir de la pratique de leur entourage. Il y aura toujours, justement, des pratiques problématiques, qui augmenteront de manière mécanique avec le nombre d’utilisateurs. Il y aura toujours des soucis éthiques dûs au fait que ces pratiques problématiques sont provoquées, et même encouragées, par la manière dont certains jeux, réseaux sociaux et objets numériques ont été conçus. Sans parler des problèmes posés par l’accessibilité de plus en plus précoce à ces jeux, réseaux et objets.
Parler le même langage
Et on en revient au point de départ : on peut être passionné de jeux vidéo et considérer que certains titres n’ont absolument rien à faire entre les mains d’enfants. Qu’ils ne méritent pas forcément tous les honneurs (introduction à marche forcée à l’école, pass culture, etc…) sous prétexte qu’il ont subi quelque excès d’indignité en des temps de plus en plus reculés. Qu’on ne doit pas se sentir obligé de défendre aveuglément n’importe lequel d’entre eux, ou n’importe lequel de ses usages, sous prétexte qu’il s’agit de notre passion. Qu’on ne doit surtout pas se sentir obligé, au nom d’un réflexe tautologique absurde, de voler au secours de n’importe quel autre écran et de n’importe lequel de ses usages sous prétexte que « les écrans » et « le numérique » sont parfois attaqués en bloc.
C’est d’ailleurs en raison de ce dernier point que pour ma part, je ne suis pas un partisan du dialogue à tout prix. En tout cas, pas avec n’importe qui, et pas dans n’importe quelles conditions. Mon expérience du « killerspieldebatte » en Allemagne m’a, à elle seule, vacciné contre une acceptation niaise et masochiste de toute critique, y compris la plus illégitime. Et en ce qui me concerne, je n’ai rien à dire à un rat d’égoût qui raconte que « le cerveau de votre gamin en train de jouer à Minecraft ressemble à un cerveau de drogué ». Néanmoins, s’il doit y avoir une interaction entre ces deux « mondes » qui ne sont pas supposés s’affronter, autant essayer de ne pas revenir, encore et encore, à cette opposition binaire pour ou contre les jeux vidéo. Et si un dialogue doit avoir lieu, autant que ce soit sur de bonnes bases : un vocabulaire commun, un sens commun, et une réelle volonté de se mettre à la place de l’autre. Conditions indispensables pour commencer à vivre dans le même monde.
Tags: anti-jeu, Anti-jeux vidéo, jeux violents, sensationnalisme, Traitement médiatique du jeu vidéo, violence
Shane Fenton est joueur depuis les années 80, et joueur passionné depuis 1990. Ouais, à peu près comme tout le monde ici, quoi. Sauf qu'en plus, il cause. Beaucoup. Mais alors beaucoup. C'est pas sain pour lui qu'il cause autant. Faudrait plutôt qu'il joue.
Email | Tous les posts de Shane Fenton